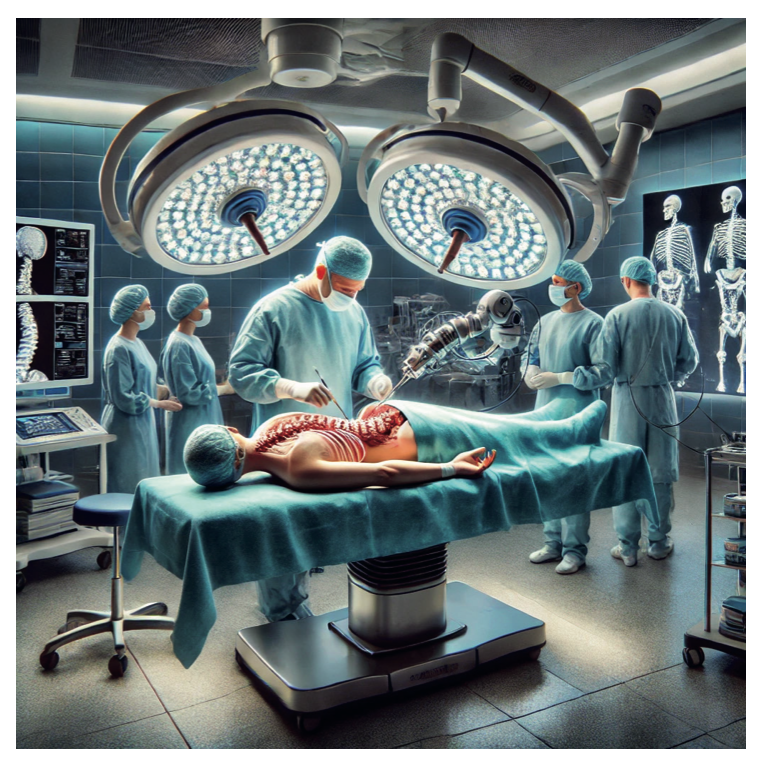Dans quel contexte en êtes-vous venu à vous intéresser à l’intelligence artificielle ?
Pr Jean-Charles Le Huec : Tout a commencé au Département des techniques et des recherches chirurgicales appliquées (DETERCA), une unité de recherche et d’enseignement du collège des sciences de la santé de l’Université de Bordeaux, que j’ai dirigée de 2001 à 2019 et dont je suis désormais le directeur adjoint émérite. Travaillant sur de nouvelles techniques chirurgicales moins invasives pour le patient, je m’étais intéressé à la chirurgie virtuelle assistée par ordinateur pour sécuriser les gestes chirurgicaux sur la colonne vertébrale. En 2008, le service d’orthopédie du CHU de Bordeaux, que je dirigeais également*, a donc été le premier service hospitalier français à se doter d’un équipement de pointe permettant de contrôler le positionnement des instruments en temps réel et de superposer ces informations aux données anatomiques du patient – soit par réalité virtuelle, également appelée navigation. La sécurité des interventions a ainsi pu augmenter de manière spectaculaire, et plusieurs autres établissements de santé nous ont emboîté le pas.
À la même époque, vous avez également créé une base de données informatisée pour nourrir les travaux de recherche clinique de votre service et du laboratoire DETERCA.
J’avais en effet, dans le passé, eu l’occasion de travailler avec le Professeur Michel Haïssaguerre qui, justement grâce à ses travaux sur les données, avait pu découvrir l’origine des troubles de la fibrillation auriculaire, ce qui a mené au développement d’une thérapie faisant désormais référence. J’étais donc conscient du potentiel offert par des données correctement exploitées, d’où ma volonté de créer cette base très versatile, customisable à souhait et bien sûr agréée par la CNIL. Il y a quelques années, constatant que des confrères américains disposaient d’une base similaire, nous avons analysé nos résultats cliniques respectifs pour la chirurgie des scolioses… et les nôtres étaient meilleurs ! Il faut dire qu’à la différence de nombreux confrères aux États-Unis, nous prenons beaucoup en compte les principes de l’équilibre sagittal, très étudié en France depuis déjà de nombreuses années – ainsi des travaux de Pierre Stagnara, Jean Dubousset ou encore Pierre Roussouly. Le taux de complications est alors moindre, car cette approche permet de mieux préparer le geste chirurgical. Nous utilisons également des tiges sur mesure pour la correction des déformations rachidiennes, ce qui assure une prise en charge plus personnalisée et facilite l’atteinte des objectifs identifiés dans le cadre du planning opératoire. Toujours est-il que j’ai alors souhaité analyser nos résultats de manière plus poussée, et me suis donc tourné vers l’intelligence artificielle.
Vous avez dû développer des algorithmes spécifiques. Pourriez-vous nous en parler ?
Nous étions en effet confrontés à deux défis. D’une part, la chirurgie de la scoliose est un acte relativement rare. Nous disposions donc d’un jeu de données restreint, ce qui n’autorisait pas véritablement une approche de type « big data ». Nous nous sommes donc tournés vers l’IA dite parcimonieuse, qui permet d’améliorer la précision des analyses et des prédictions, tout en réduisant la quantité de données nécessaires. Encore faut-il choisir les bons paramètres pour que le processus d’apprentissage soit efficace, et c’était là notre second défi : de nombreux paramètres sont à considérer pour évaluer le succès d’une chirurgie de la scoliose, lesquels prioriser ? Nous avons pu tirer les bons fils grâce à l’appui d’un mathématicien de Toulouse. Il nous fallait toutefois plus de données. Nous avons donc créé un « pool » de data avec des centres spécialisés à Lyon, Marseille et Nice, centralisant désormais des informations issues d’un millier d’interventions chirurgicales. En recherche clinique, une cohorte de cette taille est considérée comme importante. Mais cela reste relativement « petit » pour l’IA.
Pr Jean-Charles Le Huec : Tout a commencé au Département des techniques et des recherches chirurgicales appliquées (DETERCA), une unité de recherche et d’enseignement du collège des sciences de la santé de l’Université de Bordeaux, que j’ai dirigée de 2001 à 2019 et dont je suis désormais le directeur adjoint émérite. Travaillant sur de nouvelles techniques chirurgicales moins invasives pour le patient, je m’étais intéressé à la chirurgie virtuelle assistée par ordinateur pour sécuriser les gestes chirurgicaux sur la colonne vertébrale. En 2008, le service d’orthopédie du CHU de Bordeaux, que je dirigeais également*, a donc été le premier service hospitalier français à se doter d’un équipement de pointe permettant de contrôler le positionnement des instruments en temps réel et de superposer ces informations aux données anatomiques du patient – soit par réalité virtuelle, également appelée navigation. La sécurité des interventions a ainsi pu augmenter de manière spectaculaire, et plusieurs autres établissements de santé nous ont emboîté le pas.
À la même époque, vous avez également créé une base de données informatisée pour nourrir les travaux de recherche clinique de votre service et du laboratoire DETERCA.
J’avais en effet, dans le passé, eu l’occasion de travailler avec le Professeur Michel Haïssaguerre qui, justement grâce à ses travaux sur les données, avait pu découvrir l’origine des troubles de la fibrillation auriculaire, ce qui a mené au développement d’une thérapie faisant désormais référence. J’étais donc conscient du potentiel offert par des données correctement exploitées, d’où ma volonté de créer cette base très versatile, customisable à souhait et bien sûr agréée par la CNIL. Il y a quelques années, constatant que des confrères américains disposaient d’une base similaire, nous avons analysé nos résultats cliniques respectifs pour la chirurgie des scolioses… et les nôtres étaient meilleurs ! Il faut dire qu’à la différence de nombreux confrères aux États-Unis, nous prenons beaucoup en compte les principes de l’équilibre sagittal, très étudié en France depuis déjà de nombreuses années – ainsi des travaux de Pierre Stagnara, Jean Dubousset ou encore Pierre Roussouly. Le taux de complications est alors moindre, car cette approche permet de mieux préparer le geste chirurgical. Nous utilisons également des tiges sur mesure pour la correction des déformations rachidiennes, ce qui assure une prise en charge plus personnalisée et facilite l’atteinte des objectifs identifiés dans le cadre du planning opératoire. Toujours est-il que j’ai alors souhaité analyser nos résultats de manière plus poussée, et me suis donc tourné vers l’intelligence artificielle.
Vous avez dû développer des algorithmes spécifiques. Pourriez-vous nous en parler ?
Nous étions en effet confrontés à deux défis. D’une part, la chirurgie de la scoliose est un acte relativement rare. Nous disposions donc d’un jeu de données restreint, ce qui n’autorisait pas véritablement une approche de type « big data ». Nous nous sommes donc tournés vers l’IA dite parcimonieuse, qui permet d’améliorer la précision des analyses et des prédictions, tout en réduisant la quantité de données nécessaires. Encore faut-il choisir les bons paramètres pour que le processus d’apprentissage soit efficace, et c’était là notre second défi : de nombreux paramètres sont à considérer pour évaluer le succès d’une chirurgie de la scoliose, lesquels prioriser ? Nous avons pu tirer les bons fils grâce à l’appui d’un mathématicien de Toulouse. Il nous fallait toutefois plus de données. Nous avons donc créé un « pool » de data avec des centres spécialisés à Lyon, Marseille et Nice, centralisant désormais des informations issues d’un millier d’interventions chirurgicales. En recherche clinique, une cohorte de cette taille est considérée comme importante. Mais cela reste relativement « petit » pour l’IA.
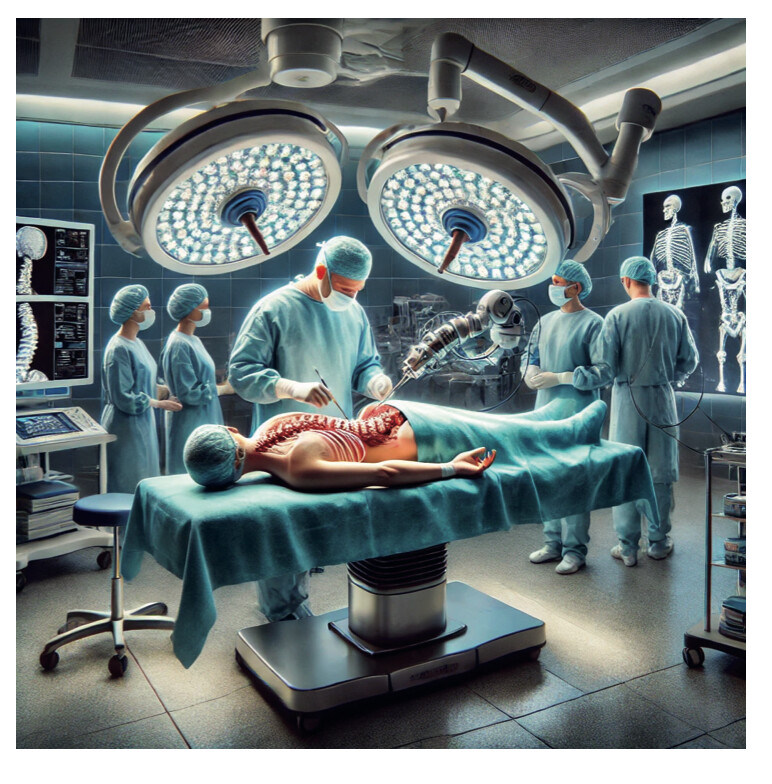
Observez-vous, aujourd’hui, une appétence pour ces technologies de la part de la communauté médicale ?
Oui, sans aucun doute. Rien ne remplacera les mains et le savoir-faire du chirurgien, mais l’IA est facilitante à plusieurs égards. D’ailleurs, le grand intérêt des médecins pour ces avancées technologiques m’a poussé à créer, à l’Université de Bordeaux, le premier diplôme universitaire français dédié à la chirurgie mini-invasive du rachis en 2004. Un partenariat a également été récemment noué entre le DETERCA – dirigé aujourd’hui par mon ami le Professeur Jean-Rodolphe Vignes – et l’Université de Poitiers, pour la création d’un diplôme inter-universitaire de chirurgie rachidienne option robotique. C’est l’occasion, pour nous, de travailler avec l’ABS-Lab de Poitiers, le Laboratoire d’anatomie, biomécanique et simulation, sur de nouvelles applications de la chirurgie robotique intégrant de l’IA. Aujourd’hui, dans la chirurgie du rachis, les robots chirurgicaux sont surtout utilisés pour positionner les vis ; leur précision est certes légèrement supérieure à celle de la navigation assistée par ordinateur, mais la différence n’est pas significative. Demain, grâce à l’IA et aux systèmes de reconnaissance automatique des images, nous pourrons disposer de robots véritablement aidants. Les technologies existent et elles sont matures. Ne reste qu’à réunir les bonnes compétences pour mettre au point ces futurs outils qui permettront de réaliser des gestes complexes avec plus de précision et une meilleure sécurité – sous réserve, bien sûr, d’obtenir le marquage CE.
Identifiez-vous des écueils particuliers qui pourraient ralentir la diffusion des applications de l’IA en santé ?
L’IA a besoin d’un carburant : les données. Et c’est justement là que le bât blesse : de nombreuses bases de données médicales sont « vides » car elles ne documentent pas le suivi du patient. Or ces informations sont primordiales pour certaines spécialités, notamment la chirurgie de la colonne vertébrale : les données du patient doivent être collectées avant l’intervention mais aussi tout au long du suivi, à deux ans, à cinq ans, à dix ans… pour pouvoir véritablement évaluer le succès de l’intervention. Il y a bien sûr des patients que l’on va perdre de vue, d’autres qui seront décédés. Mais une collecte au long cours de seulement 80 % des patients opérés suffirait pour avoir des bases de données réellement pertinentes et exploitables sur différents champs. Nous atteignons donc ici une limite du système car, ce recueil étant très fastidieux, il est peu effectué dans la pratique. Il faudrait y mettre les moyens, pour recruter du personnel dédié. En ce qui me concerne, dans toutes les études que j’ai menées à l’hôpital, j’ai financé moi-même les postes d’assistant de recherche clinique (ARC) pour justement ne perdre aucune donnée. Et cela est toujours le cas aujourd’hui, alors que je travaille en secteur libéral au sein du Groupe Bordeaux Nord Aquitaine (GBNA Santé). Une base de données bien tenue vaut de l’or !
Mais ce recueil exhaustif qui va permettre de nourrir l’IA, ne peut-il justement pas être sous-traité à l’IA ?
L’on assiste effectivement à l’arrivée de nouveaux outils intelligents pour l’exploitation documentaire qui, sous réserve que les comptes-rendus de consultation et le compte-rendu opératoires soient systématisés et structurés, peuvent collecter automatiquement les informations pertinentes et les injecter dans une base de données. Utilisées sous supervision médicale, ces solutions pourraient, dans une certaine mesure, répondre à cette problématique. Il existe désormais aussi des outils d’IA ambiante, qui peuvent retranscrire automatiquement, et de manière structurée, les échanges survenus au cours d’une consultation. Ils pourraient également être utiles pour documenter les données de suivi du patient… si les médecins sont formés à l’utilisation des bons mots-clés. Il est en tous cas certain que l’IA a un potentiel applicatif formidable en santé, et que nous n’en sommes qu’aux prémices.
Quid des inquiétudes qu’elle soulève ?
Bien que la puissance applicative de l’IA fasse l’objet de nombreux fantasmes, je suis convaincu que nous avons beaucoup à y gagner. Quant à ceux qui, aujourd’hui, ont peur de l’IA, ce sont ceux qui ne la pratiquent pas... La dynamique est désormais lancée, particulièrement chez les jeunes médecins qui sont très demandeurs d’applications intelligentes. Cela est également le cas des étudiants en médecine. D’ailleurs, nous leur ouvrons l’appétit dès la deuxième année ! Je participe à une petite formation diplômante sur l’utilisation de la navigation peropératoire, ouverte à 15 étudiants chaque année (UER). Nous recevons toujours plus d’une centaine de candidatures, preuve, s’il en est, que toutes ces avancées technologiques suscitent chez eux un réel enthousiasme.
Le mot de la fin ?
En tant que chirurgien, je suis bien conscient que je ne peux pas tout faire seul : l’anesthésiste, les IBODE, le pharmacien, les infirmiers… nous sommes tous complémentaires. Travailler sur l’IA impose cette même recherche de complémentarité. Il ne faut pas hésiter à aller vers ceux qui savent, pour fédérer les compétences nécessaires. Il faut également conserver un esprit curieux et ouvert, et s’entourer d’autres esprits curieux et ouverts – une faculté rare, car elle ne s’enseigne pas. C’est par l’expérimentation et la mise en commun des savoirs que nous continuerons d’avancer. Le retour d’expérience bien analysé nous fait beaucoup progresser, comme dans l’aviation. C’est là que je l’ai compris en passant mon brevet de pilote.
[*] En 2019, Jean-Charles Le Huec a rejoint la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, où il est à la fois le chef du service Orthopédie et traumatologie (Orthospine Unit) et le président de la Commission médicale d’établissement.
> Article paru dans Hospitalia #68, édition de février 2025, à lire ici
Oui, sans aucun doute. Rien ne remplacera les mains et le savoir-faire du chirurgien, mais l’IA est facilitante à plusieurs égards. D’ailleurs, le grand intérêt des médecins pour ces avancées technologiques m’a poussé à créer, à l’Université de Bordeaux, le premier diplôme universitaire français dédié à la chirurgie mini-invasive du rachis en 2004. Un partenariat a également été récemment noué entre le DETERCA – dirigé aujourd’hui par mon ami le Professeur Jean-Rodolphe Vignes – et l’Université de Poitiers, pour la création d’un diplôme inter-universitaire de chirurgie rachidienne option robotique. C’est l’occasion, pour nous, de travailler avec l’ABS-Lab de Poitiers, le Laboratoire d’anatomie, biomécanique et simulation, sur de nouvelles applications de la chirurgie robotique intégrant de l’IA. Aujourd’hui, dans la chirurgie du rachis, les robots chirurgicaux sont surtout utilisés pour positionner les vis ; leur précision est certes légèrement supérieure à celle de la navigation assistée par ordinateur, mais la différence n’est pas significative. Demain, grâce à l’IA et aux systèmes de reconnaissance automatique des images, nous pourrons disposer de robots véritablement aidants. Les technologies existent et elles sont matures. Ne reste qu’à réunir les bonnes compétences pour mettre au point ces futurs outils qui permettront de réaliser des gestes complexes avec plus de précision et une meilleure sécurité – sous réserve, bien sûr, d’obtenir le marquage CE.
Identifiez-vous des écueils particuliers qui pourraient ralentir la diffusion des applications de l’IA en santé ?
L’IA a besoin d’un carburant : les données. Et c’est justement là que le bât blesse : de nombreuses bases de données médicales sont « vides » car elles ne documentent pas le suivi du patient. Or ces informations sont primordiales pour certaines spécialités, notamment la chirurgie de la colonne vertébrale : les données du patient doivent être collectées avant l’intervention mais aussi tout au long du suivi, à deux ans, à cinq ans, à dix ans… pour pouvoir véritablement évaluer le succès de l’intervention. Il y a bien sûr des patients que l’on va perdre de vue, d’autres qui seront décédés. Mais une collecte au long cours de seulement 80 % des patients opérés suffirait pour avoir des bases de données réellement pertinentes et exploitables sur différents champs. Nous atteignons donc ici une limite du système car, ce recueil étant très fastidieux, il est peu effectué dans la pratique. Il faudrait y mettre les moyens, pour recruter du personnel dédié. En ce qui me concerne, dans toutes les études que j’ai menées à l’hôpital, j’ai financé moi-même les postes d’assistant de recherche clinique (ARC) pour justement ne perdre aucune donnée. Et cela est toujours le cas aujourd’hui, alors que je travaille en secteur libéral au sein du Groupe Bordeaux Nord Aquitaine (GBNA Santé). Une base de données bien tenue vaut de l’or !
Mais ce recueil exhaustif qui va permettre de nourrir l’IA, ne peut-il justement pas être sous-traité à l’IA ?
L’on assiste effectivement à l’arrivée de nouveaux outils intelligents pour l’exploitation documentaire qui, sous réserve que les comptes-rendus de consultation et le compte-rendu opératoires soient systématisés et structurés, peuvent collecter automatiquement les informations pertinentes et les injecter dans une base de données. Utilisées sous supervision médicale, ces solutions pourraient, dans une certaine mesure, répondre à cette problématique. Il existe désormais aussi des outils d’IA ambiante, qui peuvent retranscrire automatiquement, et de manière structurée, les échanges survenus au cours d’une consultation. Ils pourraient également être utiles pour documenter les données de suivi du patient… si les médecins sont formés à l’utilisation des bons mots-clés. Il est en tous cas certain que l’IA a un potentiel applicatif formidable en santé, et que nous n’en sommes qu’aux prémices.
Quid des inquiétudes qu’elle soulève ?
Bien que la puissance applicative de l’IA fasse l’objet de nombreux fantasmes, je suis convaincu que nous avons beaucoup à y gagner. Quant à ceux qui, aujourd’hui, ont peur de l’IA, ce sont ceux qui ne la pratiquent pas... La dynamique est désormais lancée, particulièrement chez les jeunes médecins qui sont très demandeurs d’applications intelligentes. Cela est également le cas des étudiants en médecine. D’ailleurs, nous leur ouvrons l’appétit dès la deuxième année ! Je participe à une petite formation diplômante sur l’utilisation de la navigation peropératoire, ouverte à 15 étudiants chaque année (UER). Nous recevons toujours plus d’une centaine de candidatures, preuve, s’il en est, que toutes ces avancées technologiques suscitent chez eux un réel enthousiasme.
Le mot de la fin ?
En tant que chirurgien, je suis bien conscient que je ne peux pas tout faire seul : l’anesthésiste, les IBODE, le pharmacien, les infirmiers… nous sommes tous complémentaires. Travailler sur l’IA impose cette même recherche de complémentarité. Il ne faut pas hésiter à aller vers ceux qui savent, pour fédérer les compétences nécessaires. Il faut également conserver un esprit curieux et ouvert, et s’entourer d’autres esprits curieux et ouverts – une faculté rare, car elle ne s’enseigne pas. C’est par l’expérimentation et la mise en commun des savoirs que nous continuerons d’avancer. Le retour d’expérience bien analysé nous fait beaucoup progresser, comme dans l’aviation. C’est là que je l’ai compris en passant mon brevet de pilote.
[*] En 2019, Jean-Charles Le Huec a rejoint la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, où il est à la fois le chef du service Orthopédie et traumatologie (Orthospine Unit) et le président de la Commission médicale d’établissement.
> Article paru dans Hospitalia #68, édition de février 2025, à lire ici